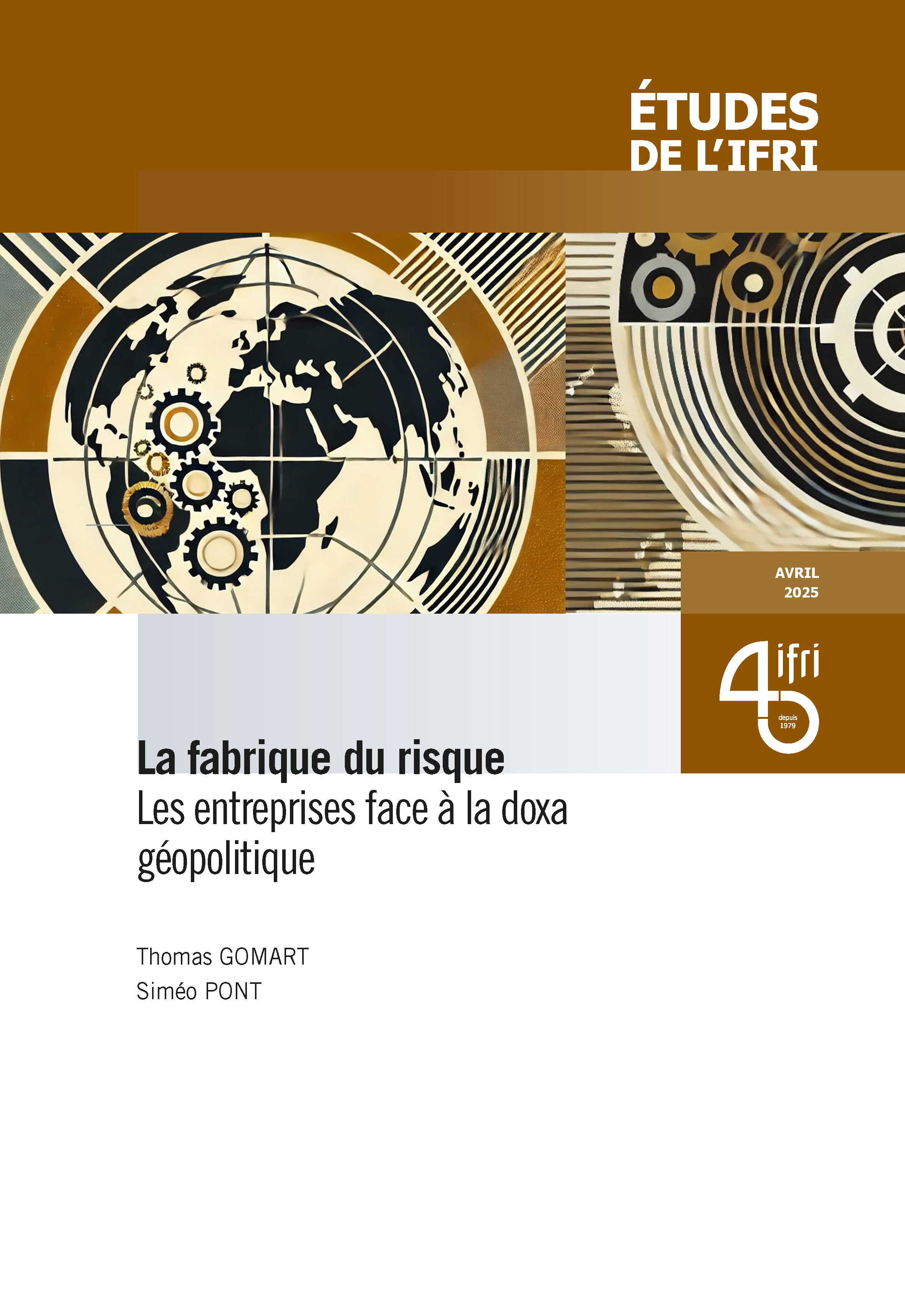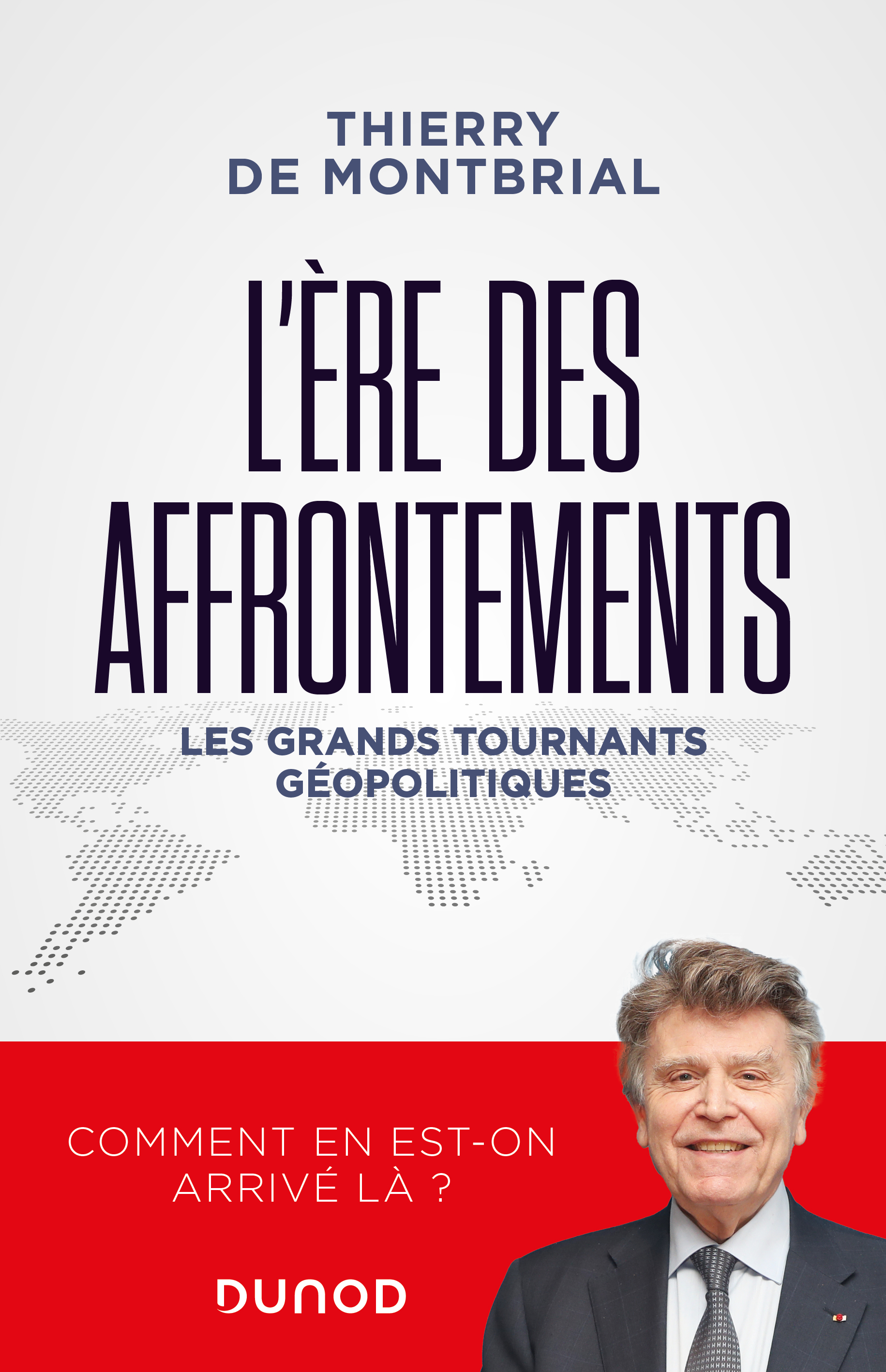La compétitivité industrielle européenne : un impératif stratégique

La compétitivité de l’Union européenne est devenue l’un des principaux enjeux pour la nouvelle Commission européenne. L’état des lieux sur les perspectives économiques en Europe, dressé consécutivement par Enrico Letta et Mario Draghi dans deux rapports commandités par les institutions européennes et publiés en 2024, est peu réjouissant.

L’Union européenne (UE) fait face à un déclin préoccupant marqué par plusieurs faiblesses structurelles. La fragmentation de son marché intérieur limite sa capacité à atteindre des économies d’échelle, contrairement à la Chine et aux États-Unis.
À cela s’ajoute une bureaucratie excessive qui freine l’innovation. Par ailleurs, l’UE accuse un retard significatif dans le domaine numérique et souffre d’un sous-investissement chronique en recherche et développement, creusant un écart croissant avec ses principaux concurrents mondiaux. Les chiffres illustrent ce recul : en 1980, la part des États-Unis dans le Produit Intérieur Brut (PIB) mondial était de 25 % et atteint aujourd’hui 26 %. Celle de l’UE, qui s’élevait à 30 %, a chuté à 17 %, tandis que la Chine est passée de 2 % à 17 % sur la même période.
À ces faiblesses structurelles s’ajoutent des facteurs conjoncturels aggravants, tels que la guerre en Ukraine qui a entraîné une augmentation des coûts de l’énergie qui touchent particulièrement les industries comme la chimie, la sidérurgie ou le papier.
Une concurrence internationale renforcée
L’Union européenne doit également faire face aux politiques industrielles protectionnistes de ses principaux concurrents, la Chine et les États-Unis.
Le programme « Made in China 2025 » illustre l’ambition chinoise, avec pour objectif de faire du pays la première puissance manufacturière mondiale d’ici 2049, en favorisant la production locale et en réduisant les dépendances étrangères.
Du côté des États-Unis, des initiatives telles que l’Inflation Reduction Act, qui prévoit des crédits d’impôt et des subventions pour stimuler la production nationale aux États-Unis, viennent renforcer les atouts compétitifs d’un pays qui affiche un taux de croissance supérieur à celui de l’Europe, une conso mmation plus vigoureuse et des coûts énergétiques nettement inférieurs.
- Contribution dans "Les 5 incontournables | Gouvernance et Comités d'audit : explorer les défis à venir" | Numéro #6 - Forvis Mazars - France.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.